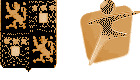EN CE TEMPS-LA
FACHES-THUMESNIL
LES REFUGIES ET RAPATRIES DE FACHES-THUMESNIL.
Souvenirs d’un jeune rapatrié.
 Pierre Berger [1911-1999] a écrit "Roubaix 1914-1918, souvenirs de guerre d’un enfant" [note] .
Pierre Berger [1911-1999] a écrit "Roubaix 1914-1918, souvenirs de guerre d’un enfant" [note] .
"Mon père nous inscrivit à la mairie et notre départ fut enfin fixé au mois d’août 1918. Seul mon père devait rester à Roubaix. A la gare, l’animation était grande et les partants, canalisés en deux colonnes, les femmes et les enfants d’un côté, les hommes – en fait vieillards ou adolescents – de l’autre, soumis à de sévères et minutieux contrôles. Une de mes sœurs dut renoncer à son violon, suspecté d’enfermer des messages occultes ; elle put heureusement le confier à une personne complaisante. Mon frère se fit si longuement attendre que ma mère s’inquiétait ; il avait des démêlés à propos d’une toile cirée qui enveloppait ses bagages. Il apparut, enfin, triomphant, ayant obtenu gain de cause. Après que le train se fût ébranlé lentement, nous aperçûmes mon père qui, du haut du pont que je connaissais bien, nous fit des signes au milieu d’une foule nombreuse. Une première étape devait nous conduire dans les Ardennes belges où nous restâmes, je crois, deux semaines. La population nous reçut avec une grande gentillesse. Si elle connaissait les mêmes souffrances morales que nous, ses privations étaient moins sévères. Le châtelain qui nous avait recueillis me témoignait une amitié discrètement protectrice. Il me prenait par la main, immense à côté de moi, et m’emmenait par les prairies et les pins ; j’étais émerveillé devant ce spectacle si neuf pour moi.

"Gare du Nord à Paris, des enfants réfugiés descendent du train qui vient des Flandres"
(cliché Meurisse – Gallica Biblilothèque Nationale de France).
Puis, de nouveau, ce fut le départ. A la suite de je ne sais plus quelles circonstances, nous occupions un compartiment isolé au milieu d’officiers allemands, avec ordre de ne déborder ni à gauche, ni à droite. Nous devions rester dans le train quarante-huit heures, pour un trajet qui nous conduisit d’abord à Düsseldorf avant de se diriger vers le Sud. Tout au long de ce voyage, nous ne vîmes que des militaires et du matériel de guerre. A aucun moment notre allure ne fut rapide, mais, à l’aube du deuxième jour, après un transbordement, puis un arrêt dans une gare où, dans un silence impressionnant, les derniers allemands quittèrent le convoi, elle se ralentit encore. Tandis que le soleil se dégageait peu à peu à l’horizon, le train poursuivait lentement son chemin. La locomotive nous tirait faiblement, sans hâte. La cadence des roues s’espaça de nouveau. Les voitures s’immobilisèrent un instant, repartirent en se tiraillant, hésitèrent avant de glisser précautionneusement. Soudain, une grande sentinelle grise se dressa à côté de la voie, en levant les bras au-devant de nous, et s’écria : Suisse ! Ce fut tout au long du convoi un moment d’intense émotion. Mes sœurs éclatèrent en sanglots. Ma mère, la tête plus froide, se contenta de regarder fixement par la fenêtre. Puis une sorte de frénésie gagna les voitures, comme l’explosion de sentiments trop longtemps contenus. Dès ce moment les Suisses allaient nous apporter cette sympathie chaude et agissante qui demeure le souvenir le plus réconfortant de mon enfance. Une plaque commémorative en conserve l’émouvant témoignage, à la gare centrale de Bâle :

"192 000 évacués des régions occupées du Nord de la France ont passé par Bâle d’octobre 1917 à octobre 1918 et ont été assistés et réconfortés par le Comité suisse de Rapatriement de Bâle et de la population bâloise en témoignage de gratitude.".
Nous fûmes très vite l’objet des soins attentifs et empressés d’une remarquable organisation : les délégués de la Croix-Rouge, les Bâlois eux-mêmes, nous distribuaient vivres et nouvelles. Et quels vivres, quelles nouvelles ! Je contemplais avec ravissement, avant d’en apprécier l’étonnante saveur, le chocolat au lait dont je défaisais avec respect les emballages luxueux et l’éclatante blancheur des petits pains croustillants qui nous étaient généreusement fournis … Lorsque nous atteignîmes les cantons romands, l’accueil devint enthousiaste. Au long du parcours, les habitants faisaient des signes de bienvenue et, sur les quais de chaque gare, venaient nombreux nous fêter. Cette traversée de la Suisse fut vraiment un enchantement ; la beauté des paysages, extraordinairement nouveaux pour moi, avec leurs lacs lumineux et leurs montagnes coiffées de blancheur, s’harmonisait avec notre état d’âme. En fin de journée, après avoir contourné le lac de Genève, nous vîmes apparaître Evian, la France. L’accueil affectueux et empressé de la population fut suivi d’un défilé dans les rues de la ville dont j’ai conservé un souvenir alerte et ému ; puis les rouages de la guerre nous reprirent une fois encore. Tout le soir, et jusqu’à une heure avancée de la nuit, les officiers du deuxième bureau s’efforçaient d’obtenir le maximum de renseignements … Une commission médicale nous observa au cours de la journée suivante. Je me trouvais parmi un groupe d’enfants qu’un major américain attirait doucement à lui, avec une bienveillance attentive, pour un examen méthodique et minutieux. A chacun de nous il hochait la tête, puis son regard attristé et grave se portait vers les mères anxieuses. Quatre ans de privations, de carences multiples, à une époque où on ignorait le rôle de vitamines et la nécessité de certains sels minéraux, où les techniques de remplacement étaient rudimentaires, ne pouvaient pas manquer de laisser de profondes traces sur de jeunes organismes.
A Lyon, les autorités nous installèrent dans un immense hangar – du moins, c’est ainsi que le voient mes yeux d’aujourd’hui – aménagé en dortoir. C’est là que se terminait notre odyssée de réfugiés. Dès lors, nous n’étions plus que de simples voyageurs pour atteindre notre but : un petit village perdu au cœur du Morvan. Les quelques heures de chemin de fer qui nous restaient à parcourir ne m’ont laissé que des impressions fugitives. Dans une petite gare, des jeunes filles montèrent dans notre compartiment, des raquettes de tennis à la main. Plus tard, mes sœurs m’ont dit qu’elles avaient été surprises, tant se révélait grand le contraste avec la vie que nous venions de quitter : il nous paraissait étrange qu’on pût se livrer à des occupations futiles dans une nation en guerre."