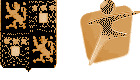EN CE TEMPS-LA
FACHES-THUMESNIL
DEUX ANS DE CAPTIVITE CHEZ LES ALLEMANDS.
3 Novembre 1916 – 11 Novembre 1918.
Les premiers moments qui suivirent cette journée furent pénibles. Depuis longtemps déjà logés déplorablement, nous nous trouvions il est vrai, relativement heureux dans nos baraques ; mais comme il s’en fallait de beaucoup pour que tout allât bien ! Ainsi la place manquait, nous n’avions pu nous placer comme nous l’aurions voulu, ce qui fait qu’il existait une regrettable promiscuité dont souffrirent beaucoup les meilleurs d’entre nous. Les vols étaient fréquents, il fallait se méfier de ses voisins et constamment avoir l’œil sur ses affaires. L’union était de plus en plus impossible, entre personnes de classes différentes éprouvant d’avance les uns pour les autres une instinctive antipathie. Les Lillois, Roubaisiens et villageois qui composaient notre bataillon se méprisaient réciproquement et ne faisaient qu’aggraver par leurs discordes leur triste situation. Au point de vue matériel nous avions à nous plaindre du manque d’eau et des objets les plus indispensables à la vie. Nous eûmes enfin à supporter les derniers assauts de ce terrible hiver qui semblait ne vouloir jamais se terminer puisque le 20 avril la neige tombait encore !
Brusquement survinrent les chaleurs. La transition nous fut funeste. Une épidémie de dysenterie sévit dans le camp et y fit de nombreuses victimes. Il y eut un moment de terreur panique parmi nous, en quelques jours on constata quatorze décès. On aurait pu facilement enrayer le progrès de la maladie, mais on comprend que des hommes affaiblis, incapables de manger les choses écœurantes qui faisaient le fond de notre nourriture, étaient, faute de soins, condamnés à une mort certaine. Je ne voudrais pas m’étendre sur cette période douloureuse et insister sur le côté horrible des spectacles dont je fus témoin. Je ne puis pourtant passer sous silence le récit des souffrances que subirent nos malheureux camarades à leurs derniers moments. Ce n’est que lorsqu’il leur était complètement impossible de marcher que nos bourreaux consentaient à les exempter de travail et à les laisser en repos ; c’était d’ailleurs tout ce qu’ils se bornaient à faire pour eux ; pas de soins, aucune pitié à attendre, aucun adoucissement à espérer, bien au contraire ils semblaient vouloir encore augmenter leurs souffrances et hâter le moment de leur fin. Je citerai deux faits à l’appui de mes dires et qui seront une preuve de leur véracité.
J’ai dit plus haut que les malades étaient difficilement reconnus comme tels. L’un d’eux épuisé par une diarrhée qui durait depuis plusieurs jours, n’avait pu obtenir d’être examiné et se voyait forcé de se rendre au chantier. Il vint un moment où il lui fut impossible de se mouvoir et il se laissa tomber en cours de route ; il fut brutalement relevé à coups de crosse par un soldat qui l’obligea ensuite à accomplir sa tâche. Cette dernière épreuve l’acheva, le soir il se coucha et resta dès lors dans le coma. Il s’éteignit le lendemain. Un autre que j’ai connu particulièrement avait auprès de lui un ami qui ne le quittait pas et l’entourait de tous les soins qu’il était en son pouvoir de lui donner. Le malade gardait le lit, un matin il ne put se lever. Voulant le faire assister à l’appel on l’envoya chercher ; il apparut en se traînant jusqu’au seuil de la baraque dans un aspect pitoyable, malgré ses prières, on ne le laissa se retirer que l’appel terminé. Quand nous revînmes le soir il n’était plus. Personne ne l’avait assisté dans ses derniers moments, il n’avait pas même eu cette suprême consolation de voir en mourant une figure amie.
C’est ainsi que finirent toutes les victimes de cette épidémie, plus tristement et combien moins honorablement que le soldat qui tombe sur le champ de bataille. Ce n’est que par les chiffres que l’on pourrait donner une idée des ravages causés par la maladie mais je n’en puis pas citer. Les Allemands finirent enfin par s’émouvoir de cet état de choses, une visite sanitaire eut lieu et des mesures sérieuses furent prises, qui eurent pour résultat une diminution rapide des cas.
Désormais jusqu’au mois de juin les journées allaient se suivre et se ressembler toutes, quelques incidents insignifiants en apparence venaient seuls en rompre la monotonie. La remise des colis par exemple était pour nous un évènement. Le départ des malades réformés qui se chargeaient des commissions pour nos parents, l’arrivée de leurs remplaçants - des Roubaisiens très peu recommandables dont beaucoup sortaient de prison - la découverte d’un voleur à qui on administrait alors une formidable raclée au grand amusement de la chambrée, voilà des choses qui excitaient l’intérêt de beaucoup d’entre nous.
Pendant tout le mois de mai comme je crois l’avoir dit, la journée de travail avait été de neuf heures, nous partions le matin pour revenir le soir après avoir mangé au chantier et passé au dehors le moment de la pleine chaleur. Les travaux se poursuivaient avec activité ; on avait commencé par niveler un terrain accidenté qu’il fallait en maint endroit, creuser profondément ; vint ensuite la pose des traverses et des rails, besogne très dure que nous redoutions tous ; sur un chemin bossué nous transportions, par équipes de huit ou dix hommes de lourdes pièces qui nous meurtrissaient les épaules, cela pendant plusieurs heures et sans trêve aucune. Les ouvriers allemands qui nous dirigeaient, loin de nous aider, se montraient implacables. Ils nous pressaient incessamment et exigeaient de nous une somme de travail que nous étions physiquement incapables d’accomplir, vu l’insuffisance de la nourriture et notre inexpérience. On alla jusqu’à diminuer la ration déjà si minime de ceux qu’on surprenait à se reposer. Tout commerce était interdit entre prisonniers et pionniers. Personne ne tenait compte de cette défense et quand l’occasion se présentait, nous ne manquions pas bien entendu, de revenir avec des vivres, pains ou pommes de terre. Deux de nos camarades se firent prendre un jour au retour du chantier, ils furent roués de coups et jetés aussitôt dans une cave. Tous les autres, trois heures durant, se virent contraints de rester immobiles dans la cour et ce malgré la prière qu’ils firent à plusieurs reprises de quitter leurs habits transpercés par la pluie qui n’avait cessé de tomber pendant toute la matinée. C’était comme on le voit une existence pire que celle du bagnard, elle ne dura pas heureusement. Vers la mi-juin se produisit une amélioration dans ce sens que nous n’eûmes à fournir que six ou sept heures de travail, et d’une seule traite ; cette organisation avait pour avantages, entre autres, de nous laisser plus de liberté, et ce à partir du moment où la chaleur était la plus forte. Le travail diminua aussi d’intensité.
La voie terminée, elle fut aussitôt mise à l’essai ; des wagons de matériel de tranchées arrivaient jusqu’au chantier et nous avions alors à les décharger. C’était soit du gravier que l’on rejetait à terre à la pelle (on nous donnait à décharger un wagon de 15.000 kilogrammes ; il fallait à deux, avoir terminé en trois heures environ), soit des planches, des rails, du ciment. Les journées de beau temps se passaient quelquefois sans grand mal mais les jours de pluie par contre étaient notre cauchemar. De temps en temps, l’un de nous était porté comme disparu ; profitant de l’inattention du factionnaire, il s’était évadé. Nous faisions alors des vœux pour la réussite de sa tentative, mais le plus souvent malheureusement, il était arrêté et ramené au camp. Il recevait alors des soldats une grêle de coups, d’autant plus forte que sa fuite était plus récente, puis il fallait passer quelques jours dans une cave sans air, sans lumière, d’où il ressortait généralement guéri de l’envie de recommencer (les soldats quand on leur amenait un fugitif, s’acharnaient férocement à le rouer de coups ; le séjour à la cave eut des effets désastreux sur quelques prisonniers ; deux moururent des suites de privations qu’ils y subirent). Quelques uns avaient vraiment la volonté d’arriver au but et n’hésitaient pas à récidiver, mais la plupart ne s’échappaient uniquement que pour "se donner du bon temps" aussi ne se souciaient-ils pas d’être repris et prenaient-ils peu de précautions. Mais bientôt les évasions cessèrent complètement ; seuls les Roubaisiens, composés en grande partie de têtes brûlées, continuèrent à "déserter" suivant le mot des Allemands.
On nous avait en effet promis des permissions et seuls ceux n’ayant pas encore de punitions pouvaient en profiter. Nous puisâmes dès lors notre courage dans l’espoir de revoir les nôtres. Le moment vint enfin où nous vîmes partir les premiers permissionnaires ; c’était au début de juillet, d’autres suivirent et désormais allait s’établir entre nos parents et nous un échange de nouvelles qui adoucit un peu notre situation. Les départs avaient lieu tous les dix jours, durée de la permission, et par petits groupes de dix à douze au plus. A partir du 30 octobre la vie suit son cours habituel jusqu’au 22 décembre où nous voyons arriver des soldats du ZAB25 . Il se composait de deux "gefreiter" (Steinwey et Jacob Fischer), du lieutenant Volk und Komp. Furher Feld, du lieutenant Kerstein, du sergent Triburger et de plusieurs soldats. Le lendemain après-midi eut lieu une revue ; les ouvriers étaient alignés d’abord en groupe d’appel, puis par groupe de travailleurs, sauf les cuisiniers, interprètes, etc … qui continuaient leurs fonctions. Il y eut ensuite une distribution de cigares que nous payâmes avec les bénéfices de la cantine. Le 25, Noël, travail comme d’habitude, le même pour le jour de l’an. Le 10 février on parle de nous renvoyer travailler dans notre contrée.