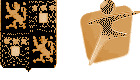EN CE TEMPS-LA
FACHES-THUMESNIL
DEUX ANS DE CAPTIVITE CHEZ LES ALLEMANDS.
3 Novembre 1916 – 11 Novembre 1918.
La première journée de travail terminée, les autres se suivirent dès lors avec une exaspérante monotonie. C’était, à la pointe du jour, le départ pour le chantier où une besogne de forçat nous attendait. Cette besogne consistait soit à creuser la terre, soit à décharger des cailloux ou du sable destinés à la construction d’une forteresse abri ; notre tâche quelquefois assez douce, était le plus souvent très dure à accomplir pour ceux à qui manquait l’habitude des travaux corporels. A midi on nous apportait la soupe dans des cuisines roulantes, la distribution qui se faisait dans l’ordre, avait rarement lieu sans bataille et c’est une des choses les plus tristes auxquelles j’aie assisté que la ruée sur les cuves de tous ces affamés échangeant des coups et se bousculant, cela sous les yeux des soldats qui ne faisaient rien pour rétablir l’ordre, bien au contraire ! Vers trois heures de l’après midi nous terminions et nous nous mettions en marche pour le camp distant de quatre à cinq kilomètres ; nous y arrivions au bout d’une heure, l’appel avait lieu, suivi de la distribution de pain et nous étions libres dans nos baraques jusqu’au lendemain matin. Les dimanches étaient semblables aux autres jours ; on ne travaillait il est vrai que jusqu’à une heure, mais l’après midi avait lieu le paiement des salaires (0,40 par jour !) puis des revues de propreté, des appels qui nous tenaient parfois jusqu’au soir. On voit par là combien peu de temps nous restait pour l’accomplissement de nos travaux d’entretien.
Les premiers temps furent durs : nous étions en effet dépourvus de tout : pas de lumière dans les baraques (la nôtre restait obscure même dans la journée et, pour laisser pénétrer un peu de clarté, il fallut pratiquer une ouverture dans la porte) ; aucun meuble, nous attendîmes quinze jours les couchettes promises dès le début et nous dormions pêle-mêle les uns sur les autres, la place nous manquait pour caser notre paquetage que nous étions forcés de laisser à terre. La nourriture, dont nous nous plaignions déjà à Tourcoing mais à tort, était absolument insuffisante, elle consistait pendant longtemps en une soupe très claire - choux raves ou choux invariablement - et en un morceau de pain de 400 grammes. C’est avec cela que nous devions fournir un effort qui nous aurait épuisés en d’autre circonstance, faire des marches de dix à douze kilomètres et rester dehors par tous les temps, dix heures de la journée ! On ne s’étonnera donc pas si nous ne pûmes résister tous à ce régime ; quelques uns parmi les plus forts - de grands villageois habitués à une forte nourriture, tombèrent les premiers. Admis à l’hôpital, ils furent réformés et libérés peu après. Nous avions tous l’espoir que cette situation ne durerait pas, et c’est ce qui nous soutenait. Des bruits couraient, malgré leur manque de fondement, nous les accueillions avec cette confiance qui fait le fond de notre caractère à nous les Français. On allait même jusqu’à citer des dates, mais à la longue comme aucun changement ne survenait, nous finîmes par ne plus rien accepter, par nous laisser vivre au jour le jour, comme des brutes. La vie que nous menions dans les conditions que l’on sait était singulièrement abêtissante : plus que les privations l’ennui nous abattait ; qu’on imagine la nature des pensées qui venaient nous assaillir pendant ces longues heures passées dans la répétition du même geste machinal, tenaillés par la faim et harcelés sans trêve par un soldat toujours menaçant ! Que la pluie pour comble se mît à tomber et nous étions désemparés jusqu’à la fin de la journée. Aussi étions-nous incapables d’arrêter notre pensée sur un sujet sérieux, nos conversations roulaient sur des futilités ou sur les lieux communs les plus rebattus, on ne songeait plus à l’avenir, ou, quand cette idée s’imposait à nous, nous fermions les yeux comme si un danger effroyable se présentait à nos yeux ; il semblait enfin que nous étions pris dans un engrenage dont jamais nous ne sortirions. Déjà chez quelques-uns on commençait à remarquer une diminution des facultés intellectuelles.
La température, pendant un mois et demi, était restée très douce et nous n’avions eu à nous plaindre que de la pluie.
A partir du 15 janvier eut lieu un refroidissement subit de l’atmosphère, la neige se mit à tomber sans discontinuer pendant plusieurs jours, le froid augmenta encore d’intensité, et, au cours de cette période gelée, nous vîmes le thermomètre descendre jusqu’à dix-sept degrés au-dessous de zéro. Nous eûmes bien à souffrir mais pas autant néanmoins qu’on pourrait le croire ; certaines matinées quand la besogne ne pressait pas, le temps se passait en partie autour des feux de plein air, nous faisions cuire les betteraves ou choux-raves dont beaucoup devaient se contenter pour le déjeuner. Après le repas de midi, nous nous sentions beaucoup mieux, réchauffés par la soupe servie presque bouillante, et étions en état de patienter jusqu’au moment du départ. Rentrés dans nos baraques nous pouvions y faire régner une bonne chaleur, grâce au combustible que nous trouvions à profusion sur la route. On peut dire que presque tous, nous résistâmes bien au froid, l’on eut à signaler que quelques cas de congestion dont aucun heureusement ne fut mortel.
Je pourrais clore ici la première partie de cette relation ; comme je l’ai dit plus haut, nous semblions en apparence résignés à notre sort et très peu songeaient à une évasion, le seul moyen pourtant de sortir de cette prison ; ceux qui avaient tenté la chance avaient tous été repris et cela n’était pas pour encourager les autres ; une distance de 150 kilomètres nous séparait du but à atteindre, et toutes sortes de difficultés - entre autre l’impossibilité de se ravitailler aux environs de Barisis complètement évacuée - s’opposait à la réussite de ce projet. Il fallut attendre le retour de la belle saison pour voir se produire des évasions qui, presque toutes d’ailleurs, échouèrent. Je dois encore mentionner un fait, insignifiant en apparence, mais qui marqua notre existence par la joie qu’il nous causa : je veux dire l’arrivée d’un colis de vivres envoyé par nos parents. Nous l’attendions depuis bien longtemps ce colis et nous avions fini par ne plus y compter ; ce fut le 26 février qu’il nous parvint ; on devine avec quel enthousiasme il fut accueilli ! C’était, pour plusieurs jours, une nourriture agréable et saine, de quoi manger à notre faim, chose que nous ne connaissions plus depuis le 1er décembre. Durant trois mois, nous n’avions donc vécu, pour ainsi dire, que de pain, la valeur nutritive de la soupe étant presque nulle, et nous devions attendre jusqu’à la mi-mai un second colis.

Prisonniers russes travaillant sur une voie de chemin de fer
près de Billy-sous-Mangiennes (Meuse) durant la Première Guerre mondiale.
Auteur : Anonyme Date: [entre 1914 et 1918]
© Jean-Michel Althuser-CRI-Nancy-Lorraine Référence: FLPH97-186
Au début de mars, les Allemands commencèrent à faire évacuer les localités voisines de Barisis ; des Russes, dont le camp touchait le nôtre, nous avaient quittés et nous ne devions pas tarder nous mêmes à les suivre. L’ordre de départ fut donné le 12, et le 13 au matin, nous abandonnâmes le village qui allait, quelques jours après, être occupé par les nôtres. Nous étions, à ce moment, au nombre de 325 environ, deux groupes de 100 et 75 hommes ayant été détachés de la colonne et dirigés quelques kilomètres plus loin. Nous dûmes marcher environ trois heures avant d’arriver à la station de chemin de fer la plus proche. Le train n’arriva que vers le soir et nous transporta sans incidents à quelques cinquante kilomètres de Barisis.