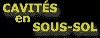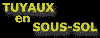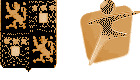|
|
|
 Les
carrières qui émaillent le sous-sol de la métropole,
en particulier le village de Lezennes, n'ont pas seulement servi à
l'exploitation de la craie. Au cours de l'histoire, les habitants les
ont reconverties en fonction de leurs besoins, tout en véhiculant
nombre de légendes sur ces cavités. Des carrières-refuge
aux champignonnières, coup d'oeil sur ceux qui ont traversé
ce labyrinthe souterrain. Les
carrières qui émaillent le sous-sol de la métropole,
en particulier le village de Lezennes, n'ont pas seulement servi à
l'exploitation de la craie. Au cours de l'histoire, les habitants les
ont reconverties en fonction de leurs besoins, tout en véhiculant
nombre de légendes sur ces cavités. Des carrières-refuge
aux champignonnières, coup d'oeil sur ceux qui ont traversé
ce labyrinthe souterrain.
 1668.
Deux mille hommes travaillent d'arrache-pied dans les carrières
de Lezennes. Prisonniers de guerre pour certains, paysans requis pour
la plupart, ils doivent extraire, comme l'exige Vauban, deux mille parpaings
de craie par jour pour la construction de la Citadelle et des fortifications
de Lille. Les carrières souterraines de Lezennes font partie des
plus anciennes de la métropole. Leur exploitation remonte au XIe
siècle. A l'époque où Louis XIV ordonne à Vauban
de « ne ménager ni l'argent ni sa peine [...] pour construire
une citadelle imprenable », elles fournissent l'essentiel de la pierre
à bâtir de la ville de Lille. 1668.
Deux mille hommes travaillent d'arrache-pied dans les carrières
de Lezennes. Prisonniers de guerre pour certains, paysans requis pour
la plupart, ils doivent extraire, comme l'exige Vauban, deux mille parpaings
de craie par jour pour la construction de la Citadelle et des fortifications
de Lille. Les carrières souterraines de Lezennes font partie des
plus anciennes de la métropole. Leur exploitation remonte au XIe
siècle. A l'époque où Louis XIV ordonne à Vauban
de « ne ménager ni l'argent ni sa peine [...] pour construire
une citadelle imprenable », elles fournissent l'essentiel de la pierre
à bâtir de la ville de Lille.
 Le
Palais Rihour, l'Hospice Comtesse, la Porte de Paris sont faits de craie
blanche de Lezennes. Le centre du village est complètement sous-miné,
tout comme certains secteurs de Hellemmes, Lille-Sud ou Fâches-Thumesnil,
creusés pour faire face aux besoins croissants de pierre à
bâtir et de chaux. Le
Palais Rihour, l'Hospice Comtesse, la Porte de Paris sont faits de craie
blanche de Lezennes. Le centre du village est complètement sous-miné,
tout comme certains secteurs de Hellemmes, Lille-Sud ou Fâches-Thumesnil,
creusés pour faire face aux besoins croissants de pierre à
bâtir et de chaux.
On s'y cache
 Dans
une région qui fut le théâtre de nombreux affrontements,
ces carrières ont permis aux populations assiégées
de se cacher en sous-sol. On trouve des traces d'occupation dès
le XVIe siècle, au moment des raids des troupes de Charles Quint.
Bien plus tard, des inscriptions sur les parois de craie - comme
celles de la carrière de la rue Kléber, à Fâches -
indiquent que des déserteurs de l'armée napoléonienne
s'y sont cachés. On peut ainsi y lire « Nous
sommes trois soldats forcés par Napoléon empereur de France
merde pour lui. Loui 18 par la grâce de Dieu venez nous délivrer
du sort que nous souffrons en 1815 » (1). Dans
une région qui fut le théâtre de nombreux affrontements,
ces carrières ont permis aux populations assiégées
de se cacher en sous-sol. On trouve des traces d'occupation dès
le XVIe siècle, au moment des raids des troupes de Charles Quint.
Bien plus tard, des inscriptions sur les parois de craie - comme
celles de la carrière de la rue Kléber, à Fâches -
indiquent que des déserteurs de l'armée napoléonienne
s'y sont cachés. On peut ainsi y lire « Nous
sommes trois soldats forcés par Napoléon empereur de France
merde pour lui. Loui 18 par la grâce de Dieu venez nous délivrer
du sort que nous souffrons en 1815 » (1).
 Les
inscriptions, mais aussi les vestiges témoignent de séjours
parfois prolongés, comme cette statue de la Vierge et cet autel,
retrouvés dans une cavité sous Lezennes. « Les
carrières du village, accessibles par l'ancienne mairie, servaient
d'abris. Elles permettaient aux habitants d'échapper aux bombardements
allemands de 1939-40 » raconte Claude Blondel, adjoint au maire
et membre du comité de la pierre de Lezennes. Les galeries souterraines
de Lille-Sud, quant à elles, étaient suffisantes pour abriter
quarante mille personnes. Les
inscriptions, mais aussi les vestiges témoignent de séjours
parfois prolongés, comme cette statue de la Vierge et cet autel,
retrouvés dans une cavité sous Lezennes. « Les
carrières du village, accessibles par l'ancienne mairie, servaient
d'abris. Elles permettaient aux habitants d'échapper aux bombardements
allemands de 1939-40 » raconte Claude Blondel, adjoint au maire
et membre du comité de la pierre de Lezennes. Les galeries souterraines
de Lille-Sud, quant à elles, étaient suffisantes pour abriter
quarante mille personnes.
On s'y perd
 Dans
plusieurs secteurs de la métropole, un grand nombre d'habitations
possèdent alors un accès. En effet, depuis les années
1920 et la fin de l'exploitation de la craie « supplantée
par la brique et le ciment » comme l'explique Etienne Kuffel,
directeur du service départemental d'inspection des carrières
souterraines, des particuliers ont su reconvertir les cavités.
Champignonnistes et exploitants de barbe de capucins - une endive
au goût très amer - y ont installé des cultures. Dans
plusieurs secteurs de la métropole, un grand nombre d'habitations
possèdent alors un accès. En effet, depuis les années
1920 et la fin de l'exploitation de la craie « supplantée
par la brique et le ciment » comme l'explique Etienne Kuffel,
directeur du service départemental d'inspection des carrières
souterraines, des particuliers ont su reconvertir les cavités.
Champignonnistes et exploitants de barbe de capucins - une endive
au goût très amer - y ont installé des cultures.
 Celles-ci
ont aujourd'hui quasiment disparu, mais les accès existent toujours.
Une aubaine pour les curieux, qui ont tenté de retrouver, sans
mesurer le danger, un endroit que les imaginations locales ont dénommé
le "Lac bleu". A cet endroit, les eaux ont envahi une cavité, prenant
une couleur bleutée au contact de la roche. Partis à la
recherche de ce lieu mythique en 1982, deux adolescents se sont perdus
dans le labyrinthe inextricable des galeries souterraines de Lezennes.
Ils y ont passé deux nuits glaciales avant d'être retrouvés,
grâce à la mobilisation de trois cents secouristes. Celles-ci
ont aujourd'hui quasiment disparu, mais les accès existent toujours.
Une aubaine pour les curieux, qui ont tenté de retrouver, sans
mesurer le danger, un endroit que les imaginations locales ont dénommé
le "Lac bleu". A cet endroit, les eaux ont envahi une cavité, prenant
une couleur bleutée au contact de la roche. Partis à la
recherche de ce lieu mythique en 1982, deux adolescents se sont perdus
dans le labyrinthe inextricable des galeries souterraines de Lezennes.
Ils y ont passé deux nuits glaciales avant d'être retrouvés,
grâce à la mobilisation de trois cents secouristes.
 On
raconte aussi qu'un trésor est caché dans les carrières
du village. 400 000 marcs d'or que Jean Sans Terre aurait dissimulés
après la bataille de Bouvines, en 1214. Mieux vaut pourtant s'abstenir !
Une expérience menée récemment révèle
qu'une personne risque de ne plus retrouver l'accès après
une progression de vingt mètres dans ces galeries étroites
et obscures. La mairie de Lezennes projette d'ouvrir les carrières
souterraines au grand public en 2004, ce qui permettra de découvrir
ce patrimoine à travers un circuit didactique. On
raconte aussi qu'un trésor est caché dans les carrières
du village. 400 000 marcs d'or que Jean Sans Terre aurait dissimulés
après la bataille de Bouvines, en 1214. Mieux vaut pourtant s'abstenir !
Une expérience menée récemment révèle
qu'une personne risque de ne plus retrouver l'accès après
une progression de vingt mètres dans ces galeries étroites
et obscures. La mairie de Lezennes projette d'ouvrir les carrières
souterraines au grand public en 2004, ce qui permettra de découvrir
ce patrimoine à travers un circuit didactique.
(1)
Cette inscription, tout comme de nombreuses informations figurant ici,
sont extraites de l'ouvrage de Bernard Bivert, "Les souterrains
du Nord", Nord patrimoine Ed., 1999. (retour)
|



![]()
![]()