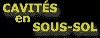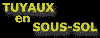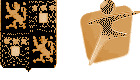|
Pôle religieux et administratif, le collège de chanoines procure l'aide divine tout en créant un nouveau réseau de dépendance.
|
|
 Sous
l'actuel palais de justice de Lille, sommeillent dans l'indifférence
les plus anciens vestiges de la ville, interdits à toute visite :
les fondations de la crypte de la collégiale Saint-Pierre, datées
du XIe siècle. Parcours initiatique et fictif avec maître
X. Sous
l'actuel palais de justice de Lille, sommeillent dans l'indifférence
les plus anciens vestiges de la ville, interdits à toute visite :
les fondations de la crypte de la collégiale Saint-Pierre, datées
du XIe siècle. Parcours initiatique et fictif avec maître
X.
 Poutres de fer, murs de béton et
verre...Le palais de justice de Lille fait grise mine. Pourtant maître X, avocat au tribunal de grande instance
sans doute depuis plus de dix ans, ne prête guère plus d'attention à ce géant aux pieds d'acier, construit en 1968 sur les bords de l'ancien quai de la Basse-Deûle. Loin de ces héros magnanimes, en quête perpétuelle de sensations fortes, il gravit les marches une par une, s'apprêtant à plaider
probablement le cas de quelque voleur à l'arraché récalcitrant. Poutres de fer, murs de béton et
verre...Le palais de justice de Lille fait grise mine. Pourtant maître X, avocat au tribunal de grande instance
sans doute depuis plus de dix ans, ne prête guère plus d'attention à ce géant aux pieds d'acier, construit en 1968 sur les bords de l'ancien quai de la Basse-Deûle. Loin de ces héros magnanimes, en quête perpétuelle de sensations fortes, il gravit les marches une par une, s'apprêtant à plaider
probablement le cas de quelque voleur à l'arraché récalcitrant.
 Une
pensée furtive pour le dîner du soir, un brin de négligence
et le voici détourné d'un parcours qu'il connaît pourtant
par coeur. Une porte dérobée... un escalier et la pénombre.
A la lueur de son zipo, maître X. se laisse guider par la curiosité
et l'attrait de ce sous-terrain peu rassurant. Une crypte, considérée
comme le plus ancien vestige de la ville donne ainsi une dimension historique
à l'édifice judiciaire. Pas question de cachot, ni de salle
de torture. Une
pensée furtive pour le dîner du soir, un brin de négligence
et le voici détourné d'un parcours qu'il connaît pourtant
par coeur. Une porte dérobée... un escalier et la pénombre.
A la lueur de son zipo, maître X. se laisse guider par la curiosité
et l'attrait de ce sous-terrain peu rassurant. Une crypte, considérée
comme le plus ancien vestige de la ville donne ainsi une dimension historique
à l'édifice judiciaire. Pas question de cachot, ni de salle
de torture.
Un pôle
religieux important
 Il s'agit en réalité des fondations de la collégiale
romane Saint-Pierre, construite à partir de 1055 sous les ordres
de Baudoin V. Maître X. ferme les yeux et laisse libre cours
à son imagination. Il lui semble pouvoir percevoir les chuchotements
des quarante chanoines installés dans l'édifice et chargés
par Baudoin V d'un travail de gestion. A la fin du XIe siècle,
Lille n'est peut-être pas encore une ville mais elle en possède
tous les éléments nécessaires. Dotée d'un
port, d'un château et d'un marché, celle que l'on prénomme
alors "Isla" grossit à vue d'oeil.
Il s'agit en réalité des fondations de la collégiale
romane Saint-Pierre, construite à partir de 1055 sous les ordres
de Baudoin V. Maître X. ferme les yeux et laisse libre cours
à son imagination. Il lui semble pouvoir percevoir les chuchotements
des quarante chanoines installés dans l'édifice et chargés
par Baudoin V d'un travail de gestion. A la fin du XIe siècle,
Lille n'est peut-être pas encore une ville mais elle en possède
tous les éléments nécessaires. Dotée d'un
port, d'un château et d'un marché, celle que l'on prénomme
alors "Isla" grossit à vue d'oeil.
 C'est
pourquoi la construction de la collégiale viendra renforcer la
supervision d'un domaine qui s'accroît et qui devient de plus en
plus difficile à maîtriser. Pôle religieux et administratif,
le collège de chanoines procure l'aide divine tout en créant
un nouveau réseau de dépendance. Dagobert, par la suite,
se servit de cette collégiale pour christianiser la région.
Pour autant, la collégiale de Lille se prévaut d'une particularité :
elle n'est basée sur le culte d'aucun saint contrairement à
la plupart des collégiales de gestion de cette époque. C'est
pourquoi la construction de la collégiale viendra renforcer la
supervision d'un domaine qui s'accroît et qui devient de plus en
plus difficile à maîtriser. Pôle religieux et administratif,
le collège de chanoines procure l'aide divine tout en créant
un nouveau réseau de dépendance. Dagobert, par la suite,
se servit de cette collégiale pour christianiser la région.
Pour autant, la collégiale de Lille se prévaut d'une particularité :
elle n'est basée sur le culte d'aucun saint contrairement à
la plupart des collégiales de gestion de cette époque.
Des vestiges ignorés
 Imaginons
que Maître X. lève le bras. La faible flamme de son briquet ne fait apparaître aucune voûte d'arrête d'origine. Quasiment détruite par un incendie en 1672 et finalement démolie en 1787 sur l'ordre du chapitre, la collégiale, qui devait faire place à une construction neuve fut définitivement abandonnée lors de la révolution qui provoqua le départ des religieux. Les vestiges, pourtant très anciens, n'ont pas été pris en compte lors de la construction du palais de justice et demeurent actuellement aux prises d'un sarcophage de béton qui dénature la valeur archéologique du lieu. Imaginons
que Maître X. lève le bras. La faible flamme de son briquet ne fait apparaître aucune voûte d'arrête d'origine. Quasiment détruite par un incendie en 1672 et finalement démolie en 1787 sur l'ordre du chapitre, la collégiale, qui devait faire place à une construction neuve fut définitivement abandonnée lors de la révolution qui provoqua le départ des religieux. Les vestiges, pourtant très anciens, n'ont pas été pris en compte lors de la construction du palais de justice et demeurent actuellement aux prises d'un sarcophage de béton qui dénature la valeur archéologique du lieu.
 En
dépit d'un plan détaillé élaboré par
les archéologues et des archives, l'imagination reste le moyen
le plus attrayant de se figurer la vie communautaire au sein de cette
collégiale. Celle-ci n'est visitable et accessible au public, qu'une
fois par an, lors de la journée du patrimoine. Une porte claque.
Maître X. époussette sa robe. Son client l'attend peut-être
depuis déjà une demi-heure. En
dépit d'un plan détaillé élaboré par
les archéologues et des archives, l'imagination reste le moyen
le plus attrayant de se figurer la vie communautaire au sein de cette
collégiale. Celle-ci n'est visitable et accessible au public, qu'une
fois par an, lors de la journée du patrimoine. Une porte claque.
Maître X. époussette sa robe. Son client l'attend peut-être
depuis déjà une demi-heure.
|



![]()
![]()